Vie de l'association
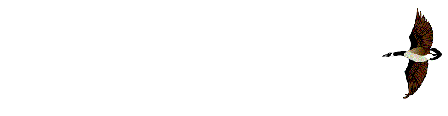 Le fabuleux destin de Georgette la Bernache
Le fabuleux destin de Georgette la Bernache
LE FABULEUX DESTIN DE GEORGETTE LA BERNACHE
En ce début d’année 2022, retour sur une petite histoire charmante qui a eu lieu près de Saint-Fargeau à l’été 2021 lors de « l’Université d’Eté » de l’association Bourgogne Franche-Comté Initiative Solidarité. Installés dans un chalet au milieu d’un parc doté d’un superbe étang, les membres de l’association ont reçu la visite surprenante d’une bernache qui a squatté les rives du plan d’eau pendant pratiquement toute la semaine. C’est le volatile qui raconte l’histoire qui suit…
« Je pense que les humains sont des êtres présomptueux. Mais inutile de me glorifier, je dois l’être tout autant. Cette attitude, je le soupçonnais depuis longtemps déjà et ma dernière expérience existentielle m’en a apporté une preuve supplémentaire.
Pour comprendre cette pensée aoûtienne, il faut d’abord que je vous relate mon arrivée au Chalet, un lieu étonnant qui ne se trouve ni dans le Jura, ni dans les Alpes ou dans les Pyrénées, en fait dans aucune des montagnes de ce globe. Il se trouve tout simplement dans l’Yonne, sur un territoire certes vallonné mais surtout recouvert de forêts. Le Chalet a été bâti là, il y a longtemps déjà, au siècle dernier plus précisément. Je n’en sais pas plus à ce sujet. L’actuelle propriétaire était encore enfant à cette époque. Imaginez qu’elle a maintenant 75 ans.
C’est un lieu verdoyant et bien entretenu où l’espace de plantations côtoie un magnifique étang. En son centre, il en émerge un petit ilot sauvage, presque inaccessible pour tout humain, sans l’utilisation d’une barque. L’une d’elles est disponible mais son fond usé comme un vieux jean laisse l’eau passer. Une vieille légende raconte qu’une belle femme à la robe blanche s’y est essayée. Elle n’a pas eu tôt fait de quelques ramées pour se retrouver à nager dans l’eau saumâtre et transformer ainsi sa magnifique tenue de princesse en maillot de bain occasionnel mais qui n’en avait pas la même efficacité. Finalement, en remontant vers la rive d’où elle était partie, elle s’est retrouvée recouverte d’un tissu poisseux et sale qui enlevait toute grâce perceptible; L’hypothétique naïade était devenue crapaud. Aussi, elle est vite retournée au Chalet pour se changer et maudire à jamais cet endroit qu’elle prenait pour un rêve éveillé.
En fait, dans ce lieu, j’y suis arrivée personnellement il y a quelques mois. Souvent, le soir, je m’installe sur le petit banc en bois situé sur le rivage à quelques pas de la bâtisse. Je m’y sens bien malgré le bruit bourdonnant et quasi permanent de la grosse départementale voisine où déboulent à pleine vitesse les automobiles et les camions. Ils profitent de la longue ligne droite pour dépasser, sans question aucune, les limitations de vitesse censées réglementer les comportements humains. Pas de radar. Alors la loi devient celle de tout un chacun. Quand la vitesse est grisante, pourquoi se refuseraient-ils le droit si merveilleux d’être grisé ?
Passons ! Ce n’est qu’un aspect accessoire de cette histoire singulière. Donc je reviens à mes moutons, plutôt à mon étang, car, en quelque sorte, c’est le mien. Je suis devenue l’habitante permanente de ce lieu. Des locataires provisoires viennent de temps à autre y passer quelques jours. A chaque fois, étonnamment, ils sont émerveillés de ma présence. Pourtant je suis un être vivant, tout comme eux, avec un corps, une tête, des membres qui permettent de me mouvoir. Oui, tout comme eux. A croire qu’ils n’ont rien vu du monde. Au départ, je pensais qu’ils auraient pu me chasser car, apparemment, ils ont payé le droit d’être là, tranquilles. Moi, je ne paie pas. Je ne paie jamais, quelque soit l’endroit où je me pose. D’ailleurs, s’il fallait le faire, je ne pourrai pas. Je n’ai jamais d’argent sur moi. Ça ne me servirait pas à grand-chose. Ce que je mange, c’est gratuit. Je prends là où je le veux, là où je le décide. Ici comme ailleurs, je me donne simplement l‘autorisation de rester sans demander l’avis à personne. N’y voyez pas une forme d’orgueil ou de mépris pour ceux chez qui je m’installe, c’est seulement comme ça. C’est ma vie et je l’assume en toute humilité car, en dehors de mes chiures qui ornent la rive, je ne fais chier personne.
Oui, aussi surprenant que cela puisse paraître, les locataires me guettent, m’alpaguent gentiment. On me hèle, on tente de m’approcher. Mais je n’aime pas cette présence trop prégnante à mes côtés. Non pas que je ressente un quelconque danger mais je ne suis pas là pour eux. Voilà l’unique raison. J’attends quelqu’un d’autre et je sais qu’il viendra. Après on repartira ensemble tous les deux.
Aussi, dés que je sens qu’on veut de moi une certaine intimité, je tourne le dos et m’écarte. Je déteste au plus haut point cette promiscuité justifiée par l’attrait que je pourrais susciter. Cette promiscuité, je ne l’accepte que de celui qui viendra me chercher. Lui, ce n’est pas pareil. On a quelque chose de commun qui nous rapproche sans qu’on ait à se dire un mot. Un instinct peut-être qui ne s’explique pas, en tous les cas pas avec des mots. Il me suffit juste de ma plume avec laquelle je n’écris rien, mais c’est comme si j’écrivais des mots d’amour. Bon, je m’égare ! Je m’égare ! Me voilà partie à vous raconter ma vie intime.
Donc je vous disais que je ne me mêle à personne sauf à qui vous savez maintenant. On ne mélange pas les torchons et les serviettes comme on dit souvent. Moi, je me sens plutôt serviette.
Je n’ai pas de nom. Je suis qui je suis et c’est suffisant, notamment parce qu’une quelconque dénomination n’a aucun sens dans ma façon de vivre. Avec mes amis, on se reconnaît du regard, parfois au son de la voix. Quelques cris et en réponse, les mêmes pour signifier que nous sommes toujours en lien, même à distance. Et puis quand je suis seule, à quoi bon me différencier avec un patronyme complètement inutile.
Pour ce qui est de l’alimentation, sur place, je trouve de quoi me sustenter, et largement en quantité. Depuis toujours, j’ai appris à me débrouiller seule ou presque. Voilà ma vie dans tout ce qu’elle a de basique et de simple à la fois. Tous les jours, c’est la même chose. Ça me convient parfaitement. Pourtant, ces derniers jours, l’arrivée de ces gens a été quelque peu perturbante.
Du haut de la terrasse surélevée du Chalet (en fait c’est son nom. Le chalet s’appelle le Chalet comme si on nommait un homme, l’Homme, et une femme, la Femme, comme s’ils étaient uniques), donc de la terrasse, un type qui voulait sans doute me séduire m’a appelée Georgette. Ses compagnes et compagnon de location ont suivi le mouvement. Donc, pour eux, je suis devenue Georgette. Ils m’ont alors inventée une vie à dormir debout (d’ailleurs, entre parenthèses, il m’arrive de dormir debout). Ils sont partis dans un grand délire sur ce qu’était mon existence. Je les entendais du banc où je m’étais installée. Je ne leur ai pas répondu. Ils avaient l’imagination fertile mais surtout hors de propos. A quoi bon répliquer tant ils étaient heureux de leurs trouvailles, de ce regard sur moi, riche d’une existence qui n’était pas la mienne. Je souriais en douce, à ma façon, même s’ils ne le voyaient pas, y compris quand on se regardait yeux dans les yeux. Je crois que le type qui m’amenait des morceaux de pain s’était entiché de moi. A croire qu’il voulait me faire un gosse. Si j’avais accepté, on aurait fait un monstre, ça c’est sûr. Mais quand même j’en étais flattée. Paradoxalement, je n’y mettais trop d’importance. Je les laissais se satisfaire de leurs projections futiles qui devaient, de toute évidence, les rassurer comme s’ils s’identifiaient à ma solitude, très provisoire soi dit en passant, en fait une solitude qui n’en était pas une. Le jour suivant m’a donné raison. Mon compagnon a entendu mes appels. Il était maintenant à mes côtés.
Eux, de la terrasse, en voyeurs avérés, ils nous observaient tous les six. Car mon compagnon n’était pas venu seul. Cinq de nos amis l’accompagnaient. Les locataires du chalet auraient pu se sentir envahis. Mais au contraire, cela a fait redoubler leurs intentions à notre égard. Ils étaient tout simplement heureux. Sans doute pour moi d’abord. Peut-être avaient-ils peur de leur propre solitude ? Je rigolais doucement à les voir ainsi. Juste après, avec ma petite troupe, on s’est rendus sur le petit ilot an centre de l’étang, là où on pouvait enfin être tranquilles. Une des locataires nous surveillait avec des jumelles. Elle croyait sans doute qu’on ne la voyait pas. Qu’imaginait-elle donc ? Un autre nous mitraillait avec son appareil-photo muni d’un zoom puissant. Pas discret lui non plus. A croire qu’ils n’avaient que ça à faire. Pauvres d’eux. Est-ce que nous on va regarder par leurs fenêtres ? Non. Enfin généralement. Une fois, on l’a fait. En réaction. On a passé un magnifique moment qui changeait de notre quotidien si régulier.
La nuit suivante, alors qu’ils dormaient, on est montés discrètement par l’escalier. Grande chance pour nous, ils avaient oublié de fermer la porte à clé. En fait tout était ouvert. C’est beau la confiance !
On est rentrés. On regardait partout. On a ouvert les portes, les fenêtres et les volets qui ne l’étaient pas encore. On a joué à faire des courants d’air. Inévitablement, ce qui devait arriver arriva. Le bruit les a réveillés. C’est ce que nous cherchions. Plusieurs d’entre d’eux se sont levés, inquiets. Des intrus malveillants devaient être dans la maison, pensaient-ils. Nous, on s’est échappés discrètement vers l’étang mais, en même temps qu’est-ce qu’on rigolait. On était pliés de rire. Eux, ils devaient se raconter qu’il y avait eu un coup de vent violent. Ils ont dû chercher à se rassurer. Nous, on savait ce qui s’était passé. Tu parles Charles, c’est nous qui avions tout manigancé. On était assez fiers de notre escapade nocturne. On se l’est racontée en boucle un bon bout de temps.
Le matin suivant, comme si de rien n’était, Les voilà qui sont repartis à nous observer et commenter à leur façon nos faits et nos gestes. Ils n’avaient strictement rien compris des évènements de la nuit. Ils n’en avaient tiré aucune leçon. Ils croyaient savoir de nous ce qu’il est impossible de comprendre. Pour connaître vraiment nos mœurs si différentes des leurs, il faudrait qu’ils soient comme nous, ce qu’ils ne seront jamais. Des humains ne s’apparentent pas aux oiseaux et ne s’en apparenteront jamais, même en inventant les avions ou tout style d’objet volant. Ça ce n’est que de la technique. Nous, c’est notre vie. Oui, nous sommes des bernaches. Certains au Canada nous appellent aussi outardes. Non, pas moutarde ! Encore une facétie de bourguignon. Enfin peu importe.
Bernache je suis, prénommée maintenant Georgette. Et tant qu’on aimera comme je suis, je peux rester là, au bord de cet étang qui est devenu un temps le centre de ma vie. J’y suis bien comme eux le sont dans leur Chalet. On se côtoie, on s’imite, enfin une des femmes blanches habillée en jupe et haut noir essaie de marcher comme nous. Elle a l’air complètement ridicule. Mais bon, elle s’en moque. Bref on s’apprécie, chacun à notre manière. Et c’est très bien comme ça. »

